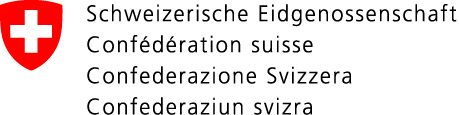Le carburant coûte cher. Il impacte significativement la rentabilité des compagnies aériennes puisqu’il peut représenter jusqu’à 40 % des coûts d’exploitation. Le monde de l’aviation mise sur les mécanismes de marché pour améliorer l’efficacité du transport aérien de personnes et de marchan-dises. À cela s’ajoutent des réglementations basées sur le marché comme le programme CORSIA, une mesure mondiale de compensation des émissions de CO2, et, prochainement, l’obligation d’incorporer des carburants d’aviation durables dans le carburant ordinaire. Avec en point de mire, des avions et des pratiques toujours plus efficaces.
- Le carburant et le CO2 représentent d’importants postes de coûts pour les compagnies aériennes. Afin de les atténuer, le secteur aéronautique développe des avions de moins en moins gourmands en kérosène tandis que les compagnies aériennes s’efforcent de trou-ver des solutions au niveau opérationnel afin d’économiser au maximum le carburant.
- Les principales mesures touchant l’exploitation sont : réduire le poids, optimiser la répartition des masses dans l’avion, réduire la vitesse de croisière, optimiser les phases de montée et de descente, adopter des itinéraires plus directs, mieux prendre en compte les conditions de vent et éliminer les circuits d’attente.
Plusieurs moyens sont activés pour accroître l’efficacité des opérations de vol :
L’aménagement intérieur des avions (sièges, conteneurs fret, etc.) s’est allégé. Le calcul de l’emport de carburant s’est aussi perfectionné : aucune tonne de carburant superflue n’est embarquée, sans toucher cependant aux réserves nécessaires. Sur les vols long-courriers, chaque tonne de carburant que l’on évite d’embarquer entraîne une diminution plus que proportionnelle de la consommation.
Le fret est réparti de manière optimale. Sur les grands avions, le carburant passe alternativement des réservoirs d’aile au réservoir d’équilibrage situé dans le stabilisateur afin que l’avion ait une traînée aussi réduite que possible en vol de croisière, sans devoir pour autant modifier les surfaces de commande. Ce mécanisme est à l’œuvre également lorsque les passagers ou des membres de l’équipage se déplacent dans la cabine.
Même si à grande altitude les avions sont capables d’atteindre des vitesses élevées en four-nissant une puissance motrice relativement peu importante du fait de la faible densité de l’air, les lois de la physique sont implacables. La moindre augmentation de la vitesse nor-male de croisière pour laquelle l’avion a été conçu demande de fournir un grand supplément de puissance. Que ce soit pour un avion en vol, pour une voiture circulant sur l’autoroute ou pour un train filant sur le réseau à grande vitesse, la règle est identique : augmenter la vitesse de 10 % exige 30 % de puissance motrice supplémentaire. Augmenter la vitesse pour rattraper un retard est inefficace en termes de consommation de carburant et plus généralement de rendement énergétique. À l’inverse, réduire légèrement la vitesse permet déjà de réaliser de sensibles économies de carburant. Aussi, les pilotes réduisent légèrement la vi-tesse de croisière dès qu’ils le peuvent à la recherche d’un compromis entre les souhaits des passagers (temps de vol, heure d’arrivée) et la consommation de carburant.
L’espace aérien européen est très fragmenté. Sans compter que certains événements, comme la guerre en Ukraine, contraignent le trafic à faire un détour. Le projet de Ciel unique européen vise à optimiser l’utilisation de l’espace aérien européen.
Des économies de carburant sont également possibles lors des phases de montée ou de descente. Les avions de ligne sont par exemple capables de parcourir les 200 derniers kilomètres de leur vol réacteurs au point mort sans devoir sans cesse remettre des gaz. En approche optimisée, ils planent jusqu’à leur destination.
Auparavant, de trop nombreux vols long-courriers, lorsqu’ils atteignaient Zurich avant 6 heures du matin (heure d’ouverture de l’aéroport) ou se succédaient à des intervalles trop rapprochés, devaient tourner sur les circuits d’attente (holdings) avant de pouvoir atterrir. Aujourd’hui, la situation est différente, grâce au projet iStream porté par la compagnie aé-rienne Swiss, le service suisse de la navigation aérienne Skyguide et l’aéroport de Zurich. Actuellement, un créneau horaire est réservé pour chaque vol de la première vague d’arrivées à l’aéroport de Zurich. Tout est pratiquement calculé à la minute près compte tenu d’une vitesse de croisière économique, de la météo et de la route. L’heure de départ de ces vols est ajustée en conséquence. Lorsqu’un fort vent d’ouest règne au-dessus de l’Atlantique (conditions de vent arrière), le départ d’Amérique du Nord est retardé afin que le vol n’arrive pas avant 6 heures à Zurich et qu’il respecte le créneau horaire. Cette procédure optimisée a permis de réduire les attentes de 96 % et de raccourcir les routes d’approche de 30 %, avec à la clé une diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO2. D’autres compagnies aériennes et d’autres aéroports européens envisagent à leur tour d’adopter le système iStream.
Les prévisions météorologiques, notamment celles concernant les vents en altitude, sont au jourd’hui très précises. Les systèmes de gestion de vol modernes permettent de mieux exploiter ces informations.
Dernière modification 24.09.2024